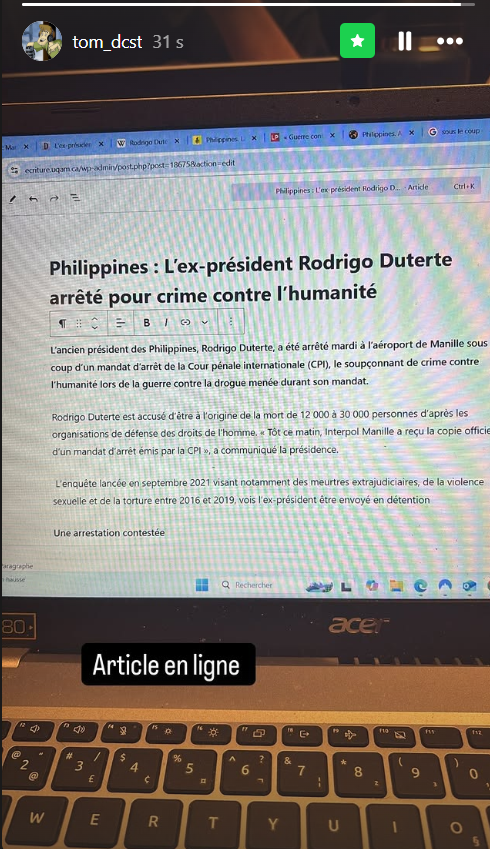27 mars 2025 - Par Da Costa, Tom - Catégorie : International
L’Itinéraire est un magazine montréalais visant à contribuer à la réinsertion sociale de personnes ayant connu l’itinérance, la dépendance aux drogues, exclues du marché du travail traditionnel ou souffrant de problèmes de santé mentale.
Un magazine est une publication périodique traitant de sujets généralistes ou spécialisés, comme la technologie, la mode et la santé. Bien que L’Itinéraire accorde une place importante à l’itinérance, le magazine aborde aussi l’actualité et la culture.
En plus d’une vocation de réinsertion, le Groupe communautaire L’Itinéraire offre de l’aide au logement, du soutien alimentaire et également un suivi psychosocial.
Il est le plus grand magazine de rue de toute l’Amérique du Nord.
Histoire :
Pour comprendre la raison de la création du journal/ magazine L’Itinéraire, il faut retourner dans le passé.
Le mot “itinérant” a commencé à apparaître seulement à la moitié des années 1980, surtout utilisé pour décrire un problème social. Avant 1980, le gouvernement fédéral investissait massivement dans la création de nouveaux logements. En 1973, la Loi nationale sur l’habitation est modifiée, ce qui mène à la construction de 20 000 logements sociaux par an.
En 1987, l’attention internationale est tournée vers l’augmentation du nombre d’itinérants dans les pays riches et développés. C’est à ce moment que le Canada a reconnu le problème. Selon le Canadian Observatory on Homelessness, c’est environ en 1980 que l’itinérance de masse émerge au Canada. Cette émergence est due au contexte économique, aux changements dans les politiques de logement et à la fermeture des institutions psychiatriques dans les années 1970-1980.
En 1984, le gouvernement canadien a réduit les dépenses en logements sociaux et en programmes connexes. En 1993, le financement pour la création de nouveaux logements prend fin.
En 1990, voyant l’apparition de l’itinérance de masse, François Thivierge, intervenant communautaire, s’est associé à une équipe composée de Pierrette Desrosiers, Denise English et Michèle Wilson. Leur projet avait pour but d’autonomiser les personnes en situation d’itinérance et de briser leur isolement social. Leur slogan “par les itinérants, pour les itinérants”.
Autrefois un journal, il est administré par des itinérants, est imprimé à plus de 500 exemplaires et distribué gratuitement dans les centres d’hébergement. L’administration voulait qu’on le considère comme un organe de promotion visant à sortir les personnes concernées de l’isolement en les incitant à participer aux activités du groupe.
En 1993, un projet-pilote qui voulait instaurer une édition payante du journal. Même si le groupe manquait d’argent pour produire une édition payante, La Presse a accepté d’aider en produisant gratuitement 3000 copies. Toutes les copies ont été rapidement vendues dans les rues de Montréal par les camelots.
Témoin du succès, le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de subventionner une partie. Ainsi, le groupe se lance dans la production d’un journal payant. Tout cela en respectant leurs idéologies premières, améliorer la vie des itinérants.
Sans réellement posséder les compétences nécessaires dans ce domaine, il demande l’aide de deux journalistes, Linda Boutin et Serge Lareault, pour mener à bien ce projet.
Le 24 mai 1994 est la sortie officielle de la première version payante du journal de L’Itinéraire. Il sera vendu 1 dollar, dont la moitié revient au camelot qui le vend. Il sera vendu dans les rues de Montréal par des personnes en processus de réintégration sociale. Un tel succès que la publication bimensuelle passera de 5000 à 25 000 de mai à décembre 1994. L’année suivante, la fréquence passera de bimensuelle à mensuelle, et l’équipe, initialement composée de 20 camelots, atteindra les 100 camelots en l’espace d’une année seulement.
En 1999, il reçoit le prix du meilleur journal de rue et le rédacteur en chef, Serge Lareault, est nommé l’une des 99 personnalités sociales par la North American Street Newspapers.
En 2006, l’Itinéraire est devenu un magazine bimensuel, imprimé en couleur. Bien établie, l’institution se crée des infrastructures de support et de formation pour pouvoir former les gens en besoins. Initialement camelot, ils seront formés pour intégrer l’équipe de rédaction.
L’initiative est un succès, et est saluée par l’Association des médias écrits communautaires du Québec et reçoit même un prix spécial de l’Office de la langue française en 2001 pour la qualité du français.

En 2015 et 2016, le magazine vit un moment difficile ; une crise interne. L’Itinéraire connaît de gros soucis financiers et les employés du média sont insatisfaits, ce qui mène à leur syndicalisation. En plus des employés, les camelots eux aussi entrent en grève contre le magazine.
Josée Panet-Raymond en 2015, puis Luc Desjardins en 2016, intègrent le magazine. Si la journaliste entre dans l’aventure Itinéraire afin d’aider le magazine à retrouver un équilibre et à se relancer, la mission initiale de Luc Desjardins est de faire fermer L’Itinéraire. Le conseil d’administration nomme M. Desjardins directeur général et le missionne, en trois mois, de s’occuper de la fermeture du média ou de trouver une solution. La fermeture était la solution préférée, mais Luc Desjardins se met en tête d’essayer de sauver le magazine.

« On apprend à HEC que la façon la plus facile de récupérer des sous dans une entreprise, c’est de virer ses employés inutiles, et de demander à ceux que l’on garde de faire deux fois le job. Moi, c’est l’inverse que j’ai fait. J’ai gardé tout le personnel et j’ai embauché du personnel supplémentaire », nous dira M. Desjardins.
À ce moment-là, son objectif est de créer une réelle cohésion d’équipe et de faire en sorte que tous les employés du magazine se sentent impliqués et écoutés. « J’ai troqué le système pyramidal traditionnel pour un système horizontal ». Le directeur prône un système où, malgré les différents postes de chacun des employés, tous ont une voix qui compte de manière équivalente.
Avec ces changements et accompagné d’une donation du nouveau directeur, le magazine se relance peu à peu. Le magazine réussit à survivre à cette crise des médias et des revenus publicitaires de 2015-2016.
Depuis 2019, L’Itinéraire est vendu dans 7 villes: Montréal, Longueuil, Saint-Jérôme, Laval, Granby, Sutton et Saint-Bruno, imprimant 24 000 copies par mois, et aujourd’hui celui-ci emploie 32 personnes dans ses différents secteurs d’activité.

Camelot en distribution de magazines
Impact social:
L’Itinéraire, c’est avant tout une aide communautaire qui accompagne les personnes vulnérables à prendre leur place avec dignité dans la société, mais c’est aussi un média ayant pour vocation d’informer la population.

L’Itinéraire s’allie régulièrement à des organismes privés ou gouvernementaux dans le but de mettre en place des projets visant à offrir du soutien alimentaire, de l’aide au logement ou de la réinsertion sociale à ceux dans le besoin.
Programme AIR:
Le programme AIR (Accompagnement et Intervention de Rue) contribue à la lutte contre l’itinérance et vise à réduire le taux de criminalité chez les itinérants dans le quartier Centre-Sud à Montréal.
Les intervenants de L’Itinéraire œuvrent en collaboration avec les commerçants et les résidents du quartier afin de faire de la sensibilisation sur les causes de l’itinérance et vont directement à la rencontre des sans-abris afin de les informer des ressources mises à leur disposition. Ils les aident également à réduire leur consommation de drogue et d’alcool et tentent de les sensibiliser aux dangers des pratiques sexuelles à risque.
Aujourd’hui, les intervenants de l’Itinéraire cumulent plus de 70 heures de sorties par semaine et rencontrent plus de 180 personnes en situation d’itinérance chaque jour. Ils distribuent également 1250 cartes repas solidaires qui permettent aux itinérants d’obtenir un repas complet dans plusieurs restaurants partenaires.
Cette année, L’Itinéraire a ouvert sa première halte-chaleur en collaboration avec le CIUSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, permettant d’accueillir 25 personnes en situation d’itinérance lors des soirs de grand froid. La halte-chaleur, ouverte du 15 janvier au 1er avril, offre des collations et des boissons chaudes, des produits d’hygiène féminine et l’accès à une salle de bain propre. Les intervenants sur place offrent également un soutien psychologique en tout temps.
Halte chaleur :
Ouverte à l’hiver 2024, la halte-chaleur Centre-Sud de L’Itinéraire, projet soutenu financièrement par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. L’équipe d’intervenants de L’Itinéraire pouvait accueillir jusqu’à 25 personnes en situation d’itinérance à chaque nuit. Si plus de personnes étaient dans le besoin, ils pouvaient bénéficier de ce service en fonction de leurs besoins individuels, venant et repartant selon leur propre rythme.
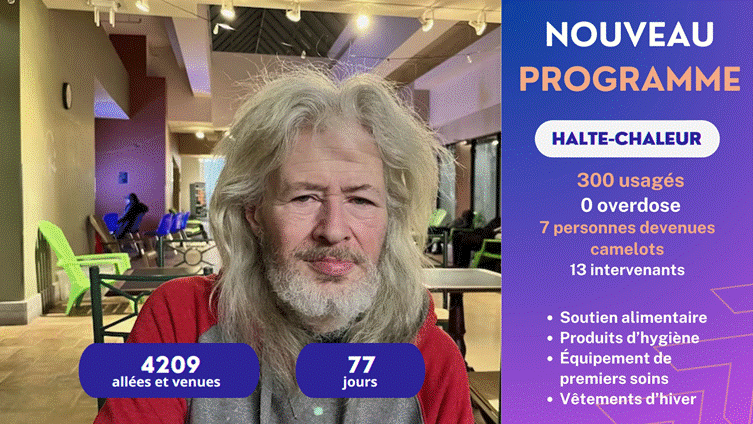
« Notre objectif est de garantir une halte-chaleur sécuritaire, accueillante et remplie de dignité offrant non seulement un abri contre le froid, mais aussi un accès à des services de base et un soutien pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation. », Luc Desjardins,
Restaurants communautaires :
Le Café Maison ronde, situé au square Cabot, se veut être un lieu de réinsertion sociale pour les Premières Nations. Il permet à ses gens issus des Premières Nations de se faire une première expérience de travail pour ceux qui « souhaitent devenir baristas, mais à qui la chance de se faire embaucher n’a pas été donnée », selon Lily, l’une des baristas du café avec qui nous avons pu nous entretenir.
En plus de donner une chance à l’emploi dans un domaine ciblé, le Café Maison ronde se définit comme un café à économie sociale. C’est-à-dire qu’il met en avant l’aspect social plutôt que l’aspect lucratif. Comme on l’a vu, le café emploie plus facilement des personnes des Premières Nations, mais il ajuste son prix en fonction du client. Il se vend comme un lieu de rassemblement et de partage. Enfin, le café organise régulièrement des distributions alimentaires parfois sucrées, parfois salées.
Café Maison ronde est l’un des piliers de la cause des Premières Nations à Montréal. Mais une autre cause tient à cœur au gérant du café : l’itinérance. En vue des initiatives mises en place citées précédemment, vous avez surement compris que cette cause les tient particulièrement à cœur. Selon Lily ; la barista de Café Maison ronde « le café se veut d’être un endroit sécuritaire pour les personnes itinérantes ».
Café de la Maison ronde
Le Café Monsieur Paul, lui, est un espace ouvert du lundi au vendredi, offrant des repas chauds à faible coût. Il accueille des personnes en situation de vulnérabilité et d’itinérance, leur fournissant un lieu de répit et certains services d’inclusion sociale et de réinsertion. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un logement, il fonctionne comme un centre de jour.
Le café propose un repas complet au prix de 6$. Des repas gratuits, sous forme de sandwiches, cafés et soupes, sont souvent offerts.

Café Monsieur Paul en dessous des locaux du magazine
Emplois :
L’Itinéraire étant un média qui vise à donner une voix aux personnes en situation d’itinérance, la majorité des rédacteurs sont des personnes ayant connu la vie dans la rue ou étant encore dans une situation précaire. En plus de créer des emplois, L’itinéraire donne un sens à la vie de ceux qui se sentent rejetés par la société en leur permettant de s’exprimer sur des sujets d’actualité ou culturels.
Les journalistes de L’Itinéraire ont l’opportunité de travailler à temps plein ou à temps partiel et ont accès à plusieurs avantages sociaux comme des assurances complètes et des possibilités de télétravail, de manière à offrir les conditions de travail les plus avantageuses possibles à ceux qui en ont besoin.

L’Itinéraire emploie aussi des camelots pour vendre des magazines principalement dans les rues et le métro de Montréal. Ces camelots sont des travailleurs autonomes qui planifient leurs propres horaires et choisissent leurs lieux de vente. C’est donc un emploi flexible, idéal pour les personnes en situation de précarité sociale.
Luc Desjardins dira : « Ils proviennent de l’itinérance, mais au final, ils proviennent de la précarité sociale. Alors oui, effectivement, l’ensemble des camelots ont des enjeux précaires au niveau ressources financières. Ils ont des problèmes reliés à la toxicomanie, qui peut être l’alcoolisme, les jeux, la drogue, et ça, ça augmente, les problèmes de santé mentale. Alors, pratiquement tous les camelots ont ces enjeux-là. La personne qui frappe, qui cogne à notre porte, doit rentrer dans un programme avec nous. Ça veut dire qu’il est accompagné par des intervenants pour différents aspects de sa vie, et avec ça, vient des progrès. Alors oui, à 99%, nos camelots ont un logement. Est-ce que le logement est adéquat ? Il y en a que oui, il y en a d’autres que c’est un peu précaire, mais ils ont des logements. Est-ce qu’ils réduisent leur niveau de consommation ? La plupart, oui. Parce que, pour rentrer à l’itinéraire, ça veut dire physiquement rentrer à l’itinéraire, il ne faut pas que tu sois en état de toxicomanie. »
Camelot au métro Champ-de-Mars
L’Itinéraire propose un programme de journalisme offert aux camelots, mais leur participation est facultative. Certains choisissent de ne pas écrire, tandis que d’autres souhaitent partager leurs expériences et leurs réflexions. Depuis sa création, L’Itinéraire s’est donné pour mission de donner une voix aux personnes marginalisées, en leur offrant un espace d’expression dans ses publications.
« J’ai des gens qui ont écrit dans le magazine qui ne savent ni lire ni écrire. Ce n’est pas eux qui ont écrit, c’est quelqu’un qui les accompagne. Mais cette personne-là, ce n’est pas parce qu’elle ne sait pas lire et ne sait pas écrire qu’elle n’a pas quelque chose à dire. Ces personnes-là écoutent la radio, écoutent la télévision, ont une opinion sur la politique ou ont une opinion X, Y, Z sur un film qu’elles ont vu. Alors, tu peux être un critique de film sans lire et sans écrire. Tu es allé voir le film, tu l’as entendu, tu l’as vu, puis après ça, tu te dis, c’est beau, ce n’est pas beau, les effets spéciaux ne sont pas bons. Tu as une opinion et tu as le droit de la partager ». Après ces mots, M. Desjardins précisera que faire écrire des gens qui n’ont pas l’éducation pour le faire eux-mêmes reste un défi.
« Tu as des bénévoles qui travaillent avec nous, qui accompagnent ces gens-là pour écrire. Il y en a d’autres qui ont le goût d’écrire des poèmes, puis il y en a d’autres qui ont des histoires à dire, qui ont besoin d’être accompagnés. »
L’Itinéraire au-delà de l’aide qu’il apporte sur des besoins « primaire », est aussi un lieu d’élévation intellectuelle pour ceux qui en ont besoin.
« Quand je lis certains camelots, il y a trois ans, puis j’ai lu trois ans plus tard, puis c’est fou l’amélioration dans leurs récits. Puis ce n’est pas nous qui corrigions tout, c’est fou, l’amélioration du français, l’amélioration surtout de la conception des idées. »

Au cours des 30 dernières années, L’Itinéraire a soutenu et travaillé avec plus de 4 000 personnes en situation de précarité. Certaines ont trouvé de nouvelles opportunités, d’autres sont décédées, et un roulement constant de camelots est observé. Actuellement, environ 150 camelots sont actifs, mais le nombre total de personnes pouvant être contactées se situe entre 300 et 400, bien que tous ne travaillent pas régulièrement.
Questionné sur la possibilité de travailler avec plus de camelot, Luc Desjardins dit que l’augmentation du nombre de bénéficiaires nécessiterait des ressources financières et humaines supplémentaires, ce qui n’est pas pour l’instant dans les capacités du magazine.
Fonctionnement :
Lors de l’exercice 2023-2024, L’Itinéraire a vendu près de 69 000 magazines dont presque 30 000 ont été distribués par les camelots eux-mêmes. Ces ventes représentent environ 300 000$ de gains.
De ces 300 000$, L’Itinéraire touche 0$. En effet les bénéfices engendrés par la vente de magazines profitent uniquement aux camelots. Le système fonctionne ainsi :
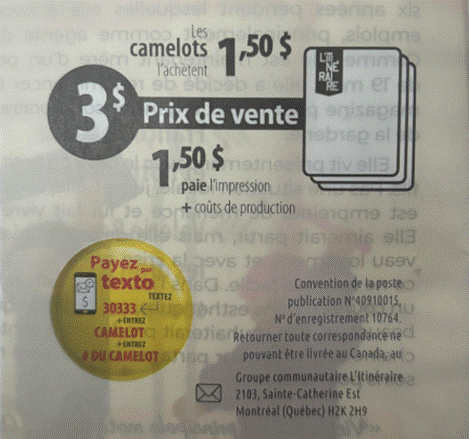
Comme les magazines ne rapportent rien au média, celui-ci doit se financer autrement. Avec 8 partenaires principaux et 16 partenaires de projet on pourrait penser que L’Itinéraire tire son argent des partenariats et de la publicité, or d’après le directeur du magazine, les partenariats ne sont pas assez nombreux.
S’il n’y en a pas assez, ce n’est pas par manque de propositions. En effet les sponsors sont très soigneusement sélectionnés pour être en accord avec les valeurs du média. Les partenaires sont donc des organismes qui travaillent pour améliorer la condition des personnes en situation de précarité sociale; des organismes comme : la STM, La Ville de Montréal ou encore la région Québec.

Accompagnée du soutien des partenaires, l’autre importante source de financement est le don. Le privé est donc en partie ce qui fait vivre le média, un système qui se base uniquement sur la générosité des particuliers. L’Itinéraire a d’ailleurs un département philanthropique dédié aux dons.
« Pour faire le magazine, ça prend une rédactrice en chef, ça prend une chef de pupitre. On a une structure comme n’importe quel journal. Ça prend un imprimeur, ça prend un infographique, puis ça prend des journalistes », rappelle M. Desjardins.
Effectivement l’aspect social du magazine prenant une place majoritaire, on occulte parfois le travail des journalistes employés par le média. Le directeur a d’ailleurs tenu à rappeler que le magazine fait partie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
Rétrospective :
Nous avons eu des difficultés pour rencontrer des intervenants. Nous avons tout de même réussi à rencontrer Luc Desjardins qui nous a accordé plus d’une heure de son temps. Il nous précisera que malheureusement il nous sera impossible de pouvoir parler à d’autres membres de son équipe, dont les camelots.
Nous avons eu l’opportunité de rencontrer deux camelots sur leur lieu de distribution, mais les deux ont effectivement refusé une entrevue.
L’expérience à tout de même était enrichissante ; nous plonger dans l’histoire d’un média aussi particulier que L’Itinéraire est très instructif. Le fonctionnement, les missions et même pouvoir voir comment les journalistes travaillaient là-bas nous a offert une autre vision que celle du « journalisme traditionnel ».
Un travail de :
Arthur Chouinard
Laurent Larose
Adam Boukali
Tom Da Costa