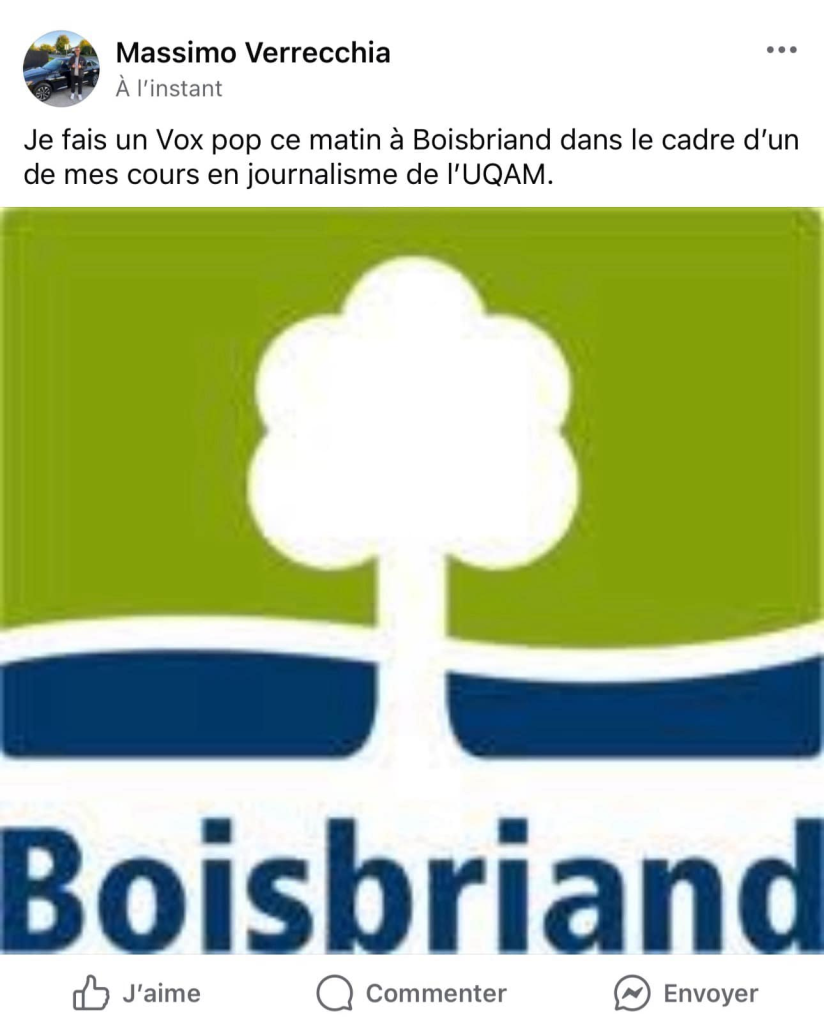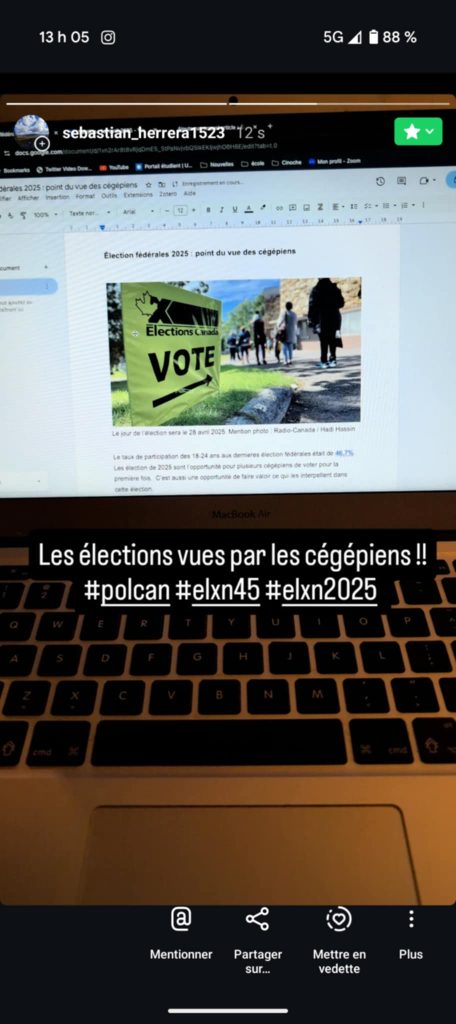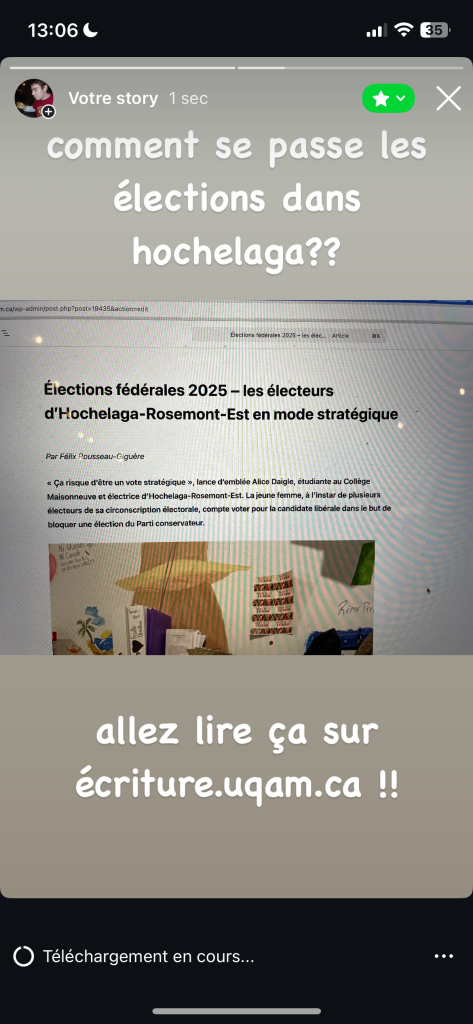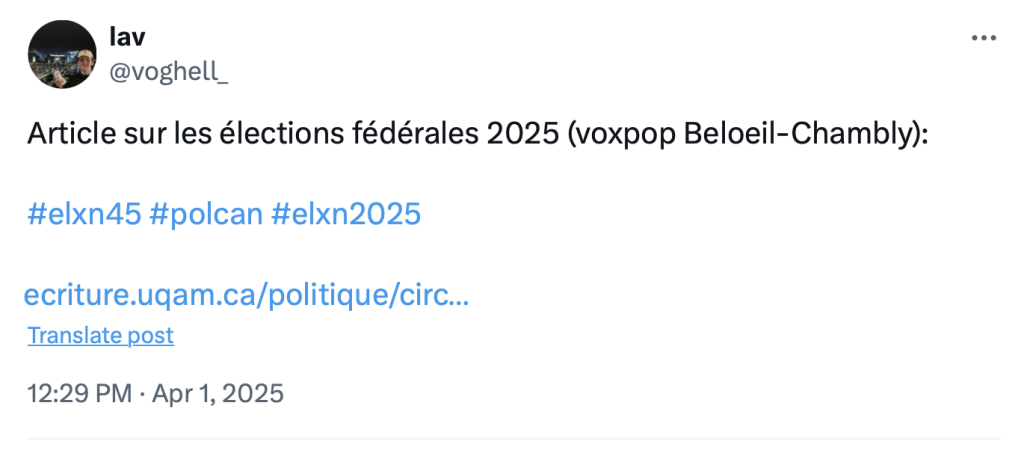2 avril 2025 - Par Lacasse, Samuel - Catégorie : Politique
Les dirigeants des partis parcourent le Canada pour tenter de convaincre les électeurs de leur accorder leur soutien pour le scrutin, prévu pour le 28 avril après une campagne de 36 jours, la durée minimale exigée par la loi. Les Canadiens iront voter dans un contexte particulier, où les menaces de Donald Trump sur la souveraineté et la stabilité économique du pays pèsent lourdement. L’UQAM est allée interroger les citoyens de Sainte-Marie-Saint-Jacques sur comment ils perçoivent la campagne.
Par Samuel Lacasse
Après une semaine de campagne largement dominée par deux principaux candidats – le nouveau premier ministre libéral Mark Carney et le conservateur Pierre Poilievre – les électeurs expriment des préoccupations liées à l’économie: éviter la récession, remettre l’économie en marche et trouver un leader compétent en matière économique pour défendre les intérêts des Canadiens.
Actuellement, les sondages montrent une avance de 4 points pour le Parti libéral, avec 42 % des intentions de vote contre 38 % pour les conservateurs. Les libéraux devancent leurs rivaux en Ontario, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, tandis qu’ils sont à égalité en Colombie-Britannique.
La peur au ventre
« Comme la guerre tarifaire avec Trump, j’ai l’impression que les différents enjeux nous submergent », s’inquiète Alex, un paysagiste de 27 ans, qui préfère prendre ses distances du climat anxiogène de la politique sauf durant la campagne électorale : « Je sais que c’est essentiel de voter et de se tenir informé, mais, au quotidien, l’impacte sur ma santé mentale est trop important », soutient-il avant d’ajouter que « Le climat social est déjà suffisamment politisé, les besoins comme les solutions sont partout autour de nous »

Si le vote avait lieu aujourd’hui, cela suffirait pour envisager un gouvernement libéral majoritaire, bien qu’il reste encore beaucoup de temps avant le jour du scrutin. « Je redoutais les prochaines élections sachant que les conservateurs semblent être en avance dans les sondages », s’est avancé Malaurie Yelle, une apparitrice de 26 ans au Cégep du Vieux Montréal.
Une question de valeurs
Bien qu’elle n’ait jamais été attirée par les libéraux, Pierre Poilièvre véhicule des idées qui lui font peur : « le droit à l’avortement, l’environnement et les valeurs conservatrices me font craindre un recul alors que le Canada a besoin d’aller de l’avant ». Affirme-t-elle fermement. Le recul sur certaines positions du Parti libéral la rend plus réticente à voter stratégiquement et à maintenir son choix sur le parti qui se rapproche le plus de ses valeurs.

Une chaude lutte s’annonce dans Sainte-Marie-Saint-Jacques alors que le député libéral sortant, Steven Guilbeault affrontera l’historien bloquiste Emmanuel Lapierre et l’épidémiologiste du NPD, Nimâ Machouf. La circonscription ayant longtemps appartenu au Bloc sous Gille Duceppe, M. Lapierre aura l’opportunité de la reprendre aux libéraux.
Matteo Monslave, un étudiant de 18 ans qui votera pour la première fois ne voit qu’un seul choix possible : « j’aimerais que ce soit une personne qui me ressemble et qui rassemble mes valeurs profondes ». Le NPD sera son choix derrière l’isoloir étant, selon lui, le seul véritable parti de gauche crédible.