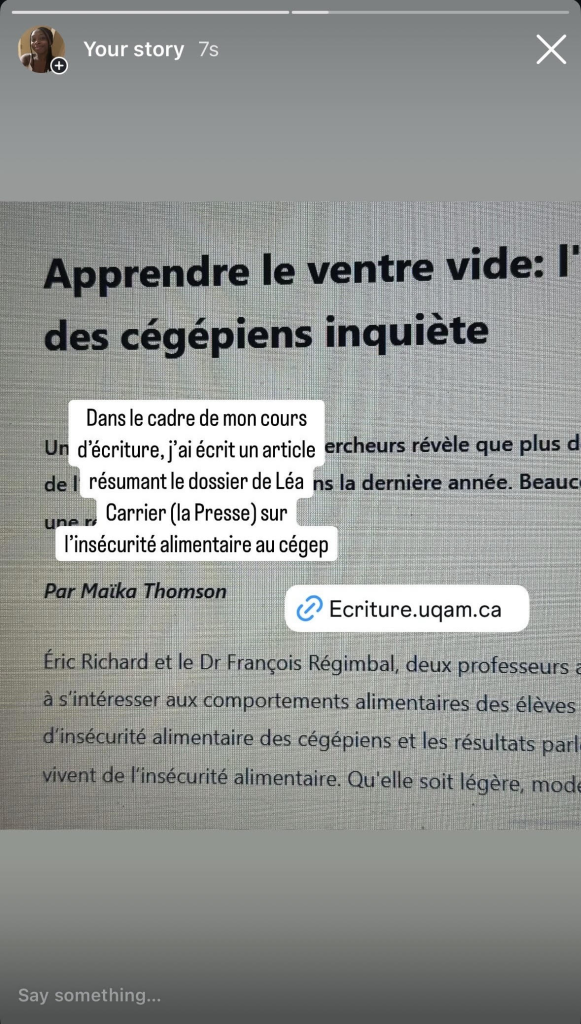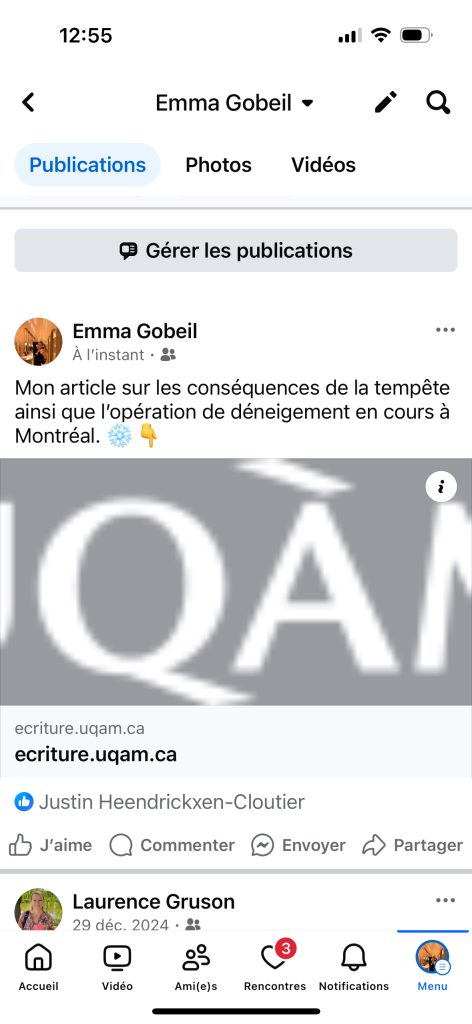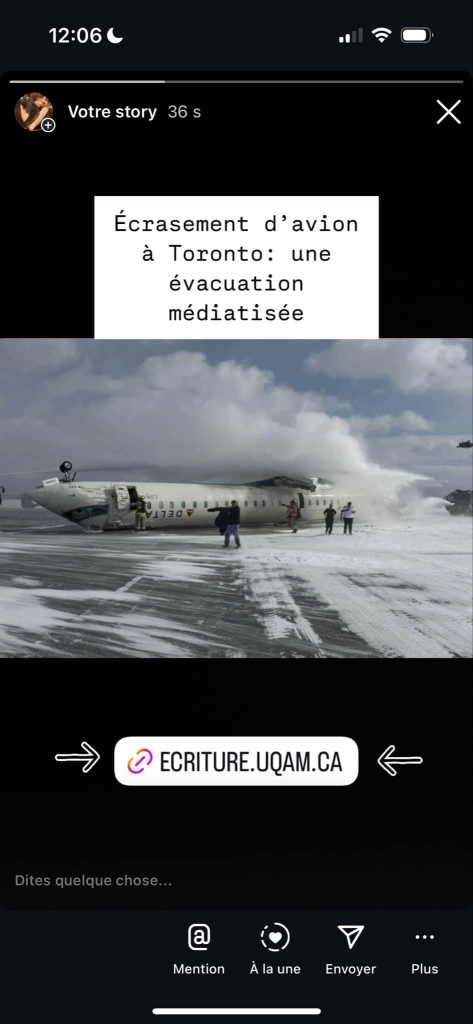27 mars 2025 - Par Rousseau-Giguère, Félix - Catégorie : Médias Politique Société
Par Marion Gagnon-Loiselle, Heidi Leuenberger, Agathe Nogues et Félix Rousseau-Giguère

Lise Bissonnette est une figure de proue du journalisme québécois et de la société québécoise, en son sens plus large. Elle a été journaliste au journal Le Devoir et l’a dirigé pendant plusieurs années avant d’entreprendre la construction de la Grande Bibliothèque à Montréal. Ce texte se veut une rétrospective somme toute chronologique de sa carrière et de ses débuts, dans le but de mettre en lumière son parcours complet et passionné.
Lise Bissonnette est née le 13 décembre 1945, en Abitibi-Témiscamingue. Sixième d’une famille de sept, Lise Bissonnette prend goût à l’écriture et la lecture dès son plus jeune âge. À l’époque où la Seconde Guerre mondiale tirait à sa fin, la religion au Québec était très présente. La grande journaliste est née dans une période de reconstruction où tous les domaines sont stimulés, comme l’innovation technique, la créativité, et la diffusion au grand public. Son enfance à Rouyn-Noranda lui fait croire qu’elle est inférieure aux élites plus cultivées.
La religion
En 1960, la religion prend encore une grande place au sein de la société. Lise Bissonnette allait au pensionnat, qui était « une niaiserie fondamentale », selon elle. Les évêques avaient la responsabilité de 1500 commissions scolaires, puisque le ministère de l’Éducation au Québec n’existait pas. Chaque établissement définissait les contenus pédagogiques nécessaires pour l’obtention du diplôme. Se départir de la communauté religieuse a été « facile » pour la future journaliste, à l’âge de quinze ans elle s’est dit « c’est fini, je ne veux plus aller à la messe ». Elle soutient qu’il n’y avait rien de révolutionnaire de ses actions, comme la société poussait vers la laïcité de l’État. « La société change et nous, on arrive juste au moment où ça se produit. Au moment où on finit notre adolescence, pouf, toute l’époque s’ouvre», raconte-t-elle.
Le Parchemin
Le patron de l’école normale avait décidé qu’il fallait un « petit journal étudiant à l’école ». L’école normale Saint-Joseph était tenue par les Soeurs grises de la Croix d’Ottawa. Ce journal « plutôt littéraire » prenait forme sur des pages d’imprimantes où, Mme Bissonnette a écrit son premier article sur un disque de Jacques Brel. À la fin de ses études, la directrice du journal passe le flambeau à Lise. « J’avais 15 ans quand j’ai dirigé mon premier journal, le Parchemin et la Presse étudiante nationale. ». Elle s’associe à la presse étudiante, qui s’appelait « la Corporation des Escoliers Griffonneurs », soulève-t-elle.
Afin de s’améliorer dans le domaine, elle faisait des cours d’été enseignés par des journalistes du Devoir et La Presse. Les ateliers d’écriture lui ont permis de développer son talent et de gagner de la confiance. « C’est là que ça a mal tourné », exprime Mme Bissonnette, en pensant au numéro spécial qu’elle avait fait.
Après le changement des règles disciplinaires dans son établissement scolaire, elle a publié un article « avant et après ». Ses collègues et elle critiquent le système fermé et déclarent le besoin de changement. Les sœurs ont suggéré qu’elle soit transférée à Montréal, loin de sa terre natale, parce qu’elles considéraient cette révolte comme inacceptable. Lise Bissonnette sortait des normes religieuses dès son plus jeune âge à l’aide du milieu des mouvements étudiants peu traditionnels.
Le rapport Parent
Pendant la Révolution tranquille, un rapport de plus de 1500 pages vise à réviser les techniques d’enseignement et d’installer une uniformité. Il propose la mise en place d’un système d’éducation intégré de la maternelle jusqu’à l’université ainsi que la création d’un ministère de l’Éducation. Dans les années 1960, l’État prend l’éducation en charge et l’Église perd son pouvoir.
« Les étudiants en éducation apprennent la pédagogie la plus autoritaire qu’il soit. Vous n’avez pas idée », s’indigne Mme Bissonnette en expliquant « les niaiseries » qu’ils apprenaient afin de devenir des enseignants. Dans son école, les sœurs redoutaient la prise d’État. Lise Bissonnette, rebelle de cœur, achète les premiers tomes du rapport et les apporte à l’école normale : « j’en parlais à tout le monde tout le temps. Pour eux, le fait que je me promenais avec ces documents-là, ça a fait partie du fait que la classe supérieure a appelé ma mère en disant, il faut qu’elle s’en aille ». Elle a donc continué son parcours au baccalauréat à l’Université de Montréal et était plongée dans les changements du système scolaire.
L’université
Pour bien des familles et des enfants issus de milieux pauvres, l’université représente autre chose que l’éducation. C’est un moyen de prouver l’accès à la richesse intellectuelle. « On est tous des transfuges de classe », déclare Lise en expliquant que l’entrée à l’université, de nos jours, est différente, contrairement à l’importance qu’on y accordait dans les années 60. « L’une des plus belles journées de ma vie, ça a été ma collation des grades de mon doctorat en 2019. » confie Mme Bissonnette. Selon elle, les générations d’aujourd’hui idéalisent moins l’obtention du diplôme.
Le Quartier Latin
« Je suis rentrée au Québec, j’ai commencé à travailler à l’UQAM comme agent de recherche, de bureau de recherche institutionnel », se rappelle Mme Bissonnette. Après presque 4 ans à travailler pour l’UQAM, elle a appris qu’un « poste s’ouvrait de chroniqueur à l’éducation au Devoir ».
En 1974, les débats politiques étaient vifs : « Très rapidement, il m’a envoyée à Québec. Et puis le poste s’est ouvert à Ottawa et personne ne voulait y aller » Maîtrisant bien l’anglais, Lise Bissonnette est devenue correspondante politique. « Je suis arrivée la veille de l’élection présidentielle. Tes journées passent, tu ne les vois pas. En plus, on est en plein cœur de la bataille politique. J’ai travaillé très fort, avec beaucoup d’intérêt »
« J’allais la nuit superviser le travail des typographes, etc. Puis je rentrais à mes cours le matin. C’était un vrai journal. Les gens l’attendaient, » explique-t-elle du journal Le Quartier latin. Le journal officiel des étudiants de l’Université de Montréal se situait sur la rue Saint-Denis dans le Quartier latin de Montréal. Ce journal est réputé pour ses prises de position et crée de vives réactions dans l’espace public. Lise Bissonnette défendait la gratuité scolaire, l’égalité des chances et la justice sociale.
Elle mentionne qu’elle avait découvert qu’elle « avait l’instinct » de signer des éditoriaux soutenu par une maîtrise de l’écriture dans son livre d’Entretiens, signé Pascale Ryan.
Le Devoir
Lise Bissonnette a complété un baccalauréat à l’Université de Montréal dans la faculté des sciences de l’éducation (1965-1978)
Cela n’avait pas été un choix délibéré de sa part. « L’engagement financier de [ses] parents ne pouvait pas aller plus loin ». Elle n’a jamais eu le désir d’enseigner, mais son rêve était d’entrer à l’université.
Déçue de l’enseignement qu’elle a reçu, elle est partie étudier à Strasbourg, en France. Sa thèse porte sur la naissance et l’essor des nouvelles universités, qui apparaissent en Europe et en Amérique sur un modèle très différent des institutions traditionnelles.
Elle suspend ses études afin de se consacrer à la coordination de la Famille des arts et de la Famille de la formation des maîtres. Elle participe à la création du premier bureau d’études institutionnelles de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Direction du Devoir
Après avoir travaillé comme journaliste au Devoir pendant de nombreuses années, Lise Bissonnette se fait offrir un poste de direction dans ce même journal par le conseil d’administration en 1990. Elle devient alors la première femme québécoise à la tête du journal. Si la nouvelle est fantastique et semble être l’accomplissement ultime de la carrière de Lise, elle ne s’en réjouit pas trop vite. À cette époque, Le Devoir est au bord de la faillite. Le journal fait face à des difficultés financières assez difficiles avec un déficit de 1,9 million de dollars.
Lise Bissonnette confie d’ailleurs que c’est pour cette raison qu’elle a été mise à la tête du Devoir. Selon elle, le conseil d’administration, pensant que Le Devoir allait s’éteindre, a préféré que la chute de celui-ci se fasse avec une femme à sa tête. « C’était l’esprit à l’époque », plaisante Lise Bissonnette en se souvenant de cette anecdote. Lise Bissonnette n’est pas une femme qui se fait marcher sur les pieds ou qui manque de caractère. Refusant que Le Devoir s’éteigne sous son nom, celle-ci, très dédiée envers le journal, décide de se démener pour qu’il survive.
De grands changements
Elle met en place trois changements principaux afin d’y arriver : la recherche de financement massif, le déménagement des locaux au centre-ville de Montréal, et la refonte du contenu du journal. « J’étais dans le feu de l’action parce que le journal allait très mal, pas seulement financièrement. Il avait perdu son aura. Il n’était plus bon à l’éditorial. Il n’était plus bon en reportage », explique Lise Bissonnette. Elle s’attaque d’abord à la mise en page du journal. Selon elle, le journal n’était pas assez attractif : « Il était gris, il était plate ». Bien qu’elle garde ses principaux traits, elle relance le journal sous une nouvelle maquette. « Je voulais donner une espèce de choc aux gens de la rédaction. Pour qu’ils arrêtent de dire que, si on mettait des photos […] et que, si on refaisait le graphisme […] c’était superficiel », raconte l’ancienne directrice.
Unes du Devoir en 1940 et en 1995. Source : Archives du Devoir
Un nouveau logo, un style plus épuré, des photos, des titres accrocheurs : voilà ce qui sera la nouvelle marque de fabrique du Devoir. Journaliste au Devoir à cette époque-là, Kathleen Lévesque s’étonne encore de ce que son ancienne directrice a été capable de faire : « elle a donné un second souffle au journal. Et ça, c’est pas rien, […] et puis elle va réussir. […] [Elle va] prendre son bâton de pèlerin, c’est le cas de le dire, puis elle va aller chercher, faire des partenariats financiers, pour soutenir, donc, la structure financière du devoir, revoir la structure éditoriale et le grand ménage graphique aussi du devoir ». Grâce à sa persévérance, elle arrive à relever le quotidien montréalais tout en maintenant son caractère unique et son indépendance éditoriale.
Une direction droite et juste
Le Devoir sous Lise Bissonnette c’est aussi une direction avec de la rigueur et des principes. « Je savais qu’en entrant au devoir, il fallait nécessairement viser la rigueur. Alors, j’avais nécessairement toujours ça en tête », se remémore Kathleen Lévesque. Dotée d’une grande plume dont elle n’oublie jamais de manquer d’applicabilité, Mme Bissonnette inspire son équipe. « Je me souviens que je suis au Devoir et je me disais “ oh que j’ai des croûtes à manger” […] on avait le goût, on avait le goût, tout le monde, de faire un effort, de mettre l’épaule à la roue. Ça, c’est sûr ». Ben oui. Vraiment. J’en ai mangé des croûtes ». Pas du tout oppressée par son époque, Lise Bissonnette n’a jamais eu peur de défendre ce en quoi elle croyait.
Mme Lévesque se souvient du jour où Mme Bissonnette, sa directrice à l’époque, avait appris, par l’entremise de ses collègues, qu’elle recevait des propos obscènes de la part d’un homme du milieu politique. « J’ai été appelée dans le bureau de Mme Bissonnette dans l’heure qui suit et elle m’a demandé ma version des faits. J’ai raconté. J’avais mon magnéto avec moi. [j’ai dit] “ D’ailleurs, voulez-vous l’entendre?” Elle ne voulait pas entendre les insanités, sauf si j’acceptais qu’elle fasse un éditorial le lendemain pour mettre un terme à la carrière politique de cet homme », développe Kathleen Lévesque. Outre la défense de la condition des femmes dans le monde du journalisme, celle-ci défend aussi ses convictions politiques. Son passage au Devoir est marqué par le positionnement souverainiste de celui-ci. Au cours de son passage au quotidien montréalais, elle écrira un grand nombre d’éditoriaux en faveur du «Oui» qui resteront dans les archives.
« Mais je me souviens, quand on a vu le grand “non” qui était là, wow! On était impressionnés. Tu sais, ça prend une force intellectuelle hors norme pour oser, écrire le “non”. C’était un coup de génie, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan marketing aussi, évidemment. Le lendemain, Le Devoir s’est envolé comme des petits pains chauds, là, évidemment », explique-t-elle, en parlant d’un des éditoriaux de son ancienne directrice à propos des discussions entourant les accords de Charlottetown en 1992.
La pionnière
Tout au long de sa carrière journalistique, Lise Bissonnette s’est aventurée dans des sentiers peu parcourus par des femmes avant elle. Plusieurs nomment sa nomination à titre de directrice du Devoir – elle était la première femme au Québec, voire au Canada, à diriger un journal – comme étant son plus grand accomplissement en tant que pionnière du monde des médias. Cependant, son arrivée en 1975 comme journaliste politique et correspondante parlementaire « est plus un moment charnière que diriger le journal », mentionne-t-elle, le sourire en coin.
À son arrivée sur la colline parlementaire à Québec, il n’y avait que deux autres femmes journalistes, note Mme Bissonnette. L’année suivante, en 1976, alors qu’elle est envoyée à Ottawa pour couvrir l’actualité politique, le constat est le même : sur un total d’environ 200 journalistes, elles étaient au plus trois femmes journalistes. L’expérience à la tribune de la presse à Ottawa ne fut pas des plus faciles pour Lise Bissonnette.
« C’était un milieu encore plus macho qu’à Québec. C’était vraiment quelque chose. Quand tu ne connais pas grand monde – je connaissais seulement deux-trois personnes – tu te sens isolé », exprime-t-elle.

Une vision unique du féminisme
Néanmoins, elle s’est démarquée et est sans contredit l’une des premières journalistes politiques au pays. À savoir si elle pense avoir eu un impact sur les générations de femmes journalistes qui l’ont suivie, Mme Bissonnette se montre plutôt distante. « Je ne me suis jamais vraiment posé la question », lance-t-elle.
De l’extérieur, il pourrait être facile de l’identifier comme une figure féministe importante des médias québécois. C’est pourtant loin d’être ce qu’elle pense. « J’ai un rapport un peu délicat avec le mouvement féministe parce que pour moi, ça allait de soi . On peut me reprocher de ne pas m’être battue, de ne pas avoir été la plus féministe. Aussi, j’ai été une patronne et c’était assez mal vu. Les gens auraient voulu que je sois plus sur les barricades, mais je ne suis pas militante. Ce n’est pas dans mon caractère », poursuit-elle.
Une aura de rigueur
En arrivant au Devoir en tant que journaliste sous la gouverne de Lise Bissonnette, Kathleen Lévesque savait qu’il fallait viser la rigueur. « Quand on ouvre les portes du Devoir, et que c’est Lise Bissonnette qui est là, et qui t’embauche, tu as le sentiment de… wow! J’ai été choisie pour travailler ici, j’étais très impressionnée », s’exclame-t-elle.
« En quoi j’ai vu le travail de Mme Bissonnette m’inspirer le plus, là, c’est vraiment sous la rigueur », poursuit-elle. Elle mentionne sa rigueur au travail et celle qu’elle attendait de la part de ses journalistes.

Mme Lévesque mentionne également les talents d’écrivaine de Lise Bissonnette comme une source intarissable d’inspiration. Ce que Lise Bissonnette écrivait, raconte–t-elle, « ça ne manquait absolument pas de profondeur. Et tout ça avec une plume agile, habile et avec le bon mot. On était d’accord ou on ne l’était pas. Ça, ce n’est pas grave. Mais par la force de sa plume, de la structure de sa pensée, la richesse et la façon de présenter son point de vue, tout ça faisait en sorte qu’on ne pouvait que l’admirer », déclare-t-elle.
L’influence de Lise Bissonnette sur elle-même et les femmes journalistes est indéniable, note Kathleen Lévesque. Selon elle, la grande dame du journalisme a prouvé aux gens que les femmes pouvaient être journalistes et gérer un journal. Le fait d’avoir dirigé Le Devoir avec autant de brio a également montré aux jeunes femmes qui visaient peut-être un poste similaire qu’elles pouvaient y arriver, croit-elle.
« Elle ne s’est pas fondue dans le moule. Elle n’a jamais été ce qu’on pouvait s’attendre d’elle. C’est doublement inspirant. Il y a des façons de faire en journalisme, mais tu as le droit d’être champ gauche et elle l’a montré. Au-delà du fait qu’elle était une femme, elle était entière et entièrement dédiée à ce à quoi elle croyait. Ça a donné des résultats », conclut-elle.
Les années BAnQ
Lise Bissonnette a joué un rôle clé dans la transformation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Son engagement a permis d’élargir la mission de l’institution en la positionnant comme un lieu central de diffusion du savoir. Sous sa direction, BAnQ n’a pas seulement été un centre de conservation, mais, dès sa création, un véritable acteur de la démocratisation du savoir. Son approche a non seulement favorisé une meilleure accessibilité aux ressources documentaires mais aussi un élargissement du public.
Elle mentionne l’importance de rendre les archives et les bibliothèques plus accessibles au grand public. « S’ils peuvent se promener dans ça, ils vont avoir plus de possibilités d’avoir accès à la culture que ma génération. Et ça, pour moi, c’est une motivation », explique Mme Bissonnette.
Elle insiste sur la nécessité d’adopter des politiques novatrices pour attirer des usagers qui, auparavant, ne se sentiraient pas concernés par ces institutions. Son travail reflète sa vision progressiste où la bibliothèque est devenue un lieu de vie et d’échanges plutôt qu’un simple entrepôt de documents.
La préservation du patrimoine québécois
L’un des éléments centraux du travail de Lise Bissonnette a été la consolidation des missions d’archives et de bibliothèque au sein d’une même institution. En intégrant ces deux fonctions sous le patronage de BAnQ, elle a favorisé une meilleure coordination de la conservation du patrimoine québécois. Cette fusion a permis de préserver des documents précieux, mais aussi d’en faciliter la consultation par les chercheurs et le grand public.
Mme Bissonnette a encouragé la numérisation des archives pour éviter leur dégradation et en faciliter l’accès aux chercheurs internationaux ou aux étudiants. La modernisation des outils de classification et de recherche documentaire permet de rendre les archives plus facilement exploitables. Son souci d’adapter les méthodes archivistiques aux nouvelles réalités technologiques rend les documents accessibles à distance. Cette initiative a permis une meilleure préservation des documents, mais aussi une démocratisation de leur consultation. Lise Bissonnette a contribué à faire rayonner le patrimoine québécois bien au-delà des frontières.
C’est en initiant des collaborations avec diverses institutions culturelles et académiques qu’elle a pu garantir une maximisation de l’utilisation des archives, ce qui favorise une partage du savoir aux générations futures.
Lise Bissonnette a eu une influence majeure sur le milieu culturel québécois en élargissant le rôle des archives et des bibliothèques, les rendant essentielles à la diffusion du savoir. « Quand les gens disent “ Ah oui, mais vous êtes d’une culture…” Et en plus de ça, tout m’est arrivé par accident dans ma culture. Tout m’est arrivé par accident. La bibliothèque, c’est la preuve qu’on est capable d’empêcher que ça soit juste par accident », confie-t-elle.
En valorisant le patrimoine créé à travers la BAnQ, elle a renforcé le lien entre le monde de la recherche et les bibliothèques.
Plusieurs programmes de collaboration entre la BAnQ et les universités québécoises, permettent, encore aujourd’hui, aux étudiants et aux chercheurs d’avoir un accès privilégié à des ressources documentaires essentielles. Cette synergie a facilité la production de nouvelles connaissances et renforcé le rôle de la BAnQ comme partenaire incontournable du monde académique.
Un modèle pour les institutions culturelles contemporaines
L’influence de Lise Bissonnette dépasse largement le cadre de la BAnQ et les archives nationales. Son approche a inspiré d’autres institutions culturelles au Québec et ailleurs dans la francophonie. Sa vision d’une bibliothèque dynamique intégrée à la vie sociale et culturelle a servi de modèle pour plusieurs autres organisations cherchant à moderniser leur approche.
Quant à sa carrière journalistique, elle a tracé la route pour des générations de journalistes à venir et son style franc, champ-gauche et rigoureux a donné lieu à de vrais débats de société et à une parole qui se faisait rare à son époque.